 |
 |
|
06/2019 |
Travail à la chaleur |
 |
La réglementation ne définit pas le travail à la
chaleur. Toutefois, au-delà de 30°C pour une activité
sédentaire, et 28°C pour un travail nécessitant une
activité physique, la chaleur peut constituer un risque
pour les salariés.
La prévention la plus efficace consiste à éviter ou au
moins à limiter l’exposition à la chaleur. Pour cela il
est possible d’agir sur l’organisation du travail
(augmentation de la fréquence des pauses, limitation du
travail physique, rotation des tâches…), l’aménagement
des locaux (zones de repos climatisées, ventilation),
les matériels et les équipements.
Pour le travail en extérieur en période de canicule, des
mesures préventives permettent de remédier aux effets de
la chaleur (travail durant les heures les moins chaudes,
mise à disposition d’eau fraîche à proximité des postes
de travail, aménagement de zones d’ombre…). Ces mesures
doivent être accompagnées d’actions d’information et de
formation des salariés. |
|
|
 lire la suite
lire la suite |
|
|
|
|
13/06/2019 |
Procès France Télécom :Jour 23 .Il y a
eu un petit manque de bon sens managérial |
 |
Le procès de France Télécom illustre de façon dramatique
comment les membres de la direction ne partagent plus le
même monde que ceux qui y travaillent. Les premiers sont
dans le monde de la prescription, des résultats
financiers, de la raison instrumentale. Leur défense est
essentiellement construite sur un argument : ils ont
édicté les bonnes prescriptions parce qu’elles étaient
parfaitement en cohérence avec les objectifs financiers
nécessaires pour redresser une entreprise en difficulté.
Les seconds sont dans le monde des vivants, des
personnes humaines ordinaires, préoccupées par leur vie
quotidienne, confronté à une réalité du travail qui les
met en danger, qui altère leur santé mentale. D’un côté
la vie et la mort sont des enjeux économiques. De
l’autre, la vie et la mort sont des enjeux existentiels.
Le procès nous dira, lequel de ces registres doit
l’emporter. |
|
|
 lire la suite
lire la suite |
|
|
|
|
23/06/2019 |
Faut-il s’inquiéter de la présence de
substances « à l’état de traces » ? |
 |
Les moyens techniques modernes permettent de détecter
dans l’air, dans l’eau, dans les cheveux ou ailleurs des
« traces » de toutes sortes de produits, parfois à des
doses infinitésimales. Près de 450 substances
potentiellement préoccupantes sont recherchées dans
l’alimentation et régulièrement suivies par l’Anses
(Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail) dans
le cadre d’ « études sur l’alimentation totales » (EAT,
études reposant sur une méthode standardisée et
recommandée par l’OMS) [1]. La liste des substances
retrouvées pourrait sembler effrayante : nickel, cobalt,
mercure, cadmium, aluminium, arsenic, plomb, strontium,
cuivre, dioxine, mycotoxines, phytoœstrogènes issus du
soja (perturbateurs endocriniens), résidus de
pesticides… Par ailleurs, de la cocaïne et d’autres
drogues illicites sont détectées dans l’air des grandes
villes [2]. Faut-il s’en inquiéter a priori ? |
|
|
 lire la suite
lire la suite |
|
|
|
|
07/06/2019 |
Marie Pezé Pendant le procès de France
Télécom, les suicides liés au travail continuent » |
 |
Depuis l’ouverture de ce procès, le 6 mai dernier, j’ai
toutefois le sentiment d’assister à une grande catharsis
nationale. C’est l’arbre qui cache la forêt. Car pendant
que ce procès sur le harcèlement moral institutionnel
trace sa route, les suicides liés au travail continuent.
Un agriculteur se suicide chaque jour, un policier tous
les deux jours, un personnel soignant met fin à ses
jours chaque semaine. Les techniques managériales
pathogènes, comme le lean management, sont non seulement
de plus en plus répandues mais aussi de plus en plus
brutales. Dans la sphère publique comme dans le privé,
les employeurs sont totalement désinhibés sur ce point.
Dans le même temps, nous assistons à un recul du droit
du travail sur les questions de santé et de sécurité.
Après la disparition des CHSCT, le rapport Lecocq
préconise par exemple de supprimer le document unique
d’évaluation des risques professionnels, qui est
pourtant un maillon essentiel de la politique de
prévention. |
|
|
 lire la suite
lire la suite |
|
|
|
|
21/06/2019 |
Effets sanitaires liés à l’exposition
aux champs électromagnétiques basses fréquences |
 |
L’Anses publie ce jour une nouvelle expertise sur les
effets sanitaires liés à l’exposition aux champs
électromagnétiques basses fréquences. Au regard des
données disponibles, l’Agence réitère ses conclusions de
2010 sur l’association possible entre l’exposition aux
champs électromagnétiques basses fréquences et le risque
à long terme de leucémie infantile, ainsi que sa
recommandation de ne pas implanter de nouvelles écoles à
proximité des lignes à très haute tension. Par ailleurs,
l’Agence souligne la nécessité de mieux maîtriser
l’exposition en milieu de travail pour certains
professionnels susceptibles d’être exposés à des niveaux
élevés de champs électromagnétiques, et parmi eux tout
particulièrement les femmes enceintes. |
|
|
 lire la suite
lire la suite |
|
|
|
|
26/06/2019 |
Procès France Telecom Jour 29.1 –
Inégalités et rapports de pouvoir au tribunal |
 |
Ces débats sur la part relative des facteurs personnels
et professionnel révèlent de façon brutale la prégnance
de rapports de pouvoir dans l’entreprise et la capacité
qu’ont ses dirigeants à imposer des organisations et des
conditions de travail délétères à l’ensemble des
salariés en choisissant de ne pas prendre en compte leur
diversité, parfois leur fragilité. Plusieurs exemples de
situations violentes (et d’autant plus douloureuses
qu’elles s’exerceront sur des personnes fragiles) sont
ainsi rapportées au cours de l’audience. On rappelle
tout d’abord la mise en œuvre d’un management par
Performance Individuelle Compare´e, soit le PIC, un
acronyme dont la sonorité en dit plus que le jargon
entrepreneurial qui le justifie). Comme indiqué par un
des collègues d’une des victimes, un « tableau était
affiché dans le service et tout le monde apparaissait
dessus, et, bien évidemment, étant donné que M. M était
sensible, on peut assimiler cette pratique à du
harcèlement, car ce tableau affichait les premiers, mais
aussi les derniers. |
|
|
 lire la suite
lire la suite |
|
|
|
|
12/06/2019 |
Infarctus sur le lieu de travail =
accident du travail ? |
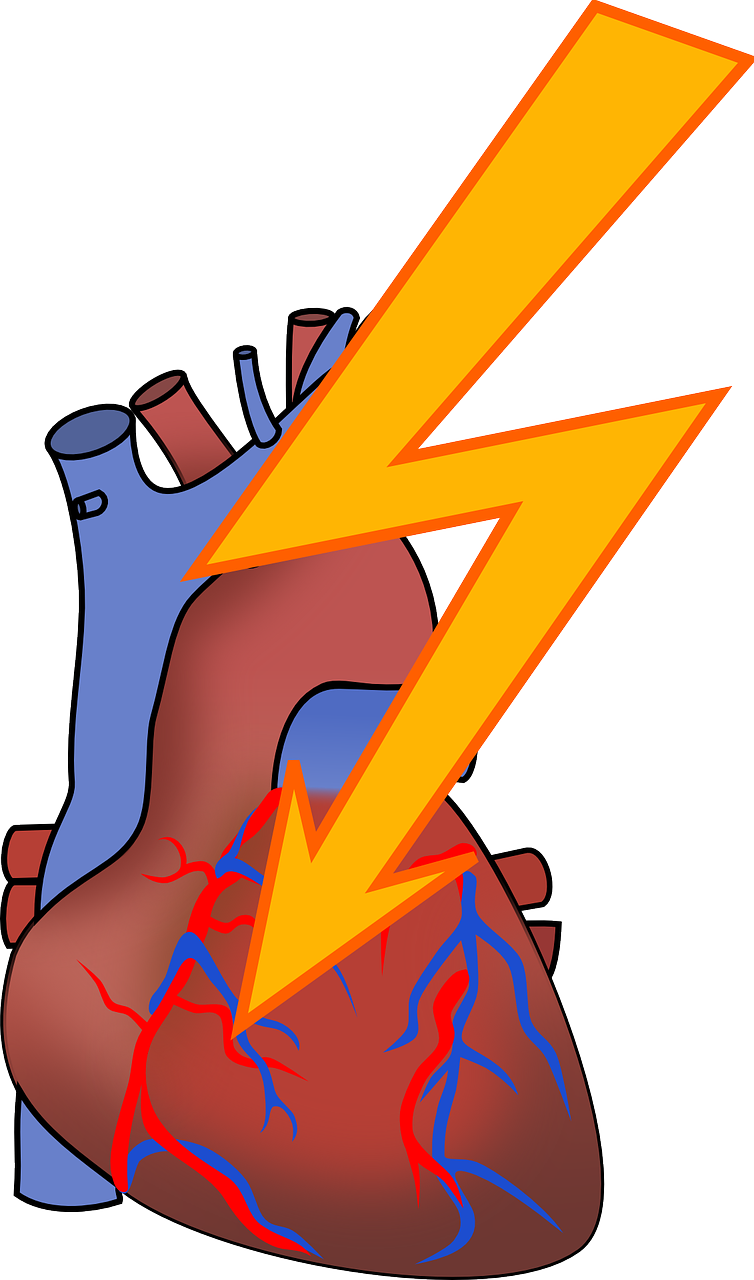
|
Jocelyn X, employé en qualité de vendeur, est victime
d'un infarctus sur son lieu de travail. Il décède
quelques jours plus tard. Cet accident est pris en
charge au titre de la législation professionnelle par la
caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.
L'employeur saisit d'un recours une juridiction de
sécurité sociale au motif principal que la présomption
d’imputabilité ne s'applique pas en cas de malaise,
lorsqu'il est établi que le salarié en a ressenti les
premiers symptômes antérieurement à son arrivée au sein
de l'entreprise et que le malaise est apparu sans qu'il
n'ait débuté son travail (il était en salle de pause),
de sorte que la lésion n'est pas survenue soudainement
au temps et au lieu de travail. L’employeur n’est pas
entendu et de plus sa demande d’expertise judiciaire
pour analyse du dossier médical est écartée par la cour
d’appel. L’employeur se pourvoit en cassation. |
 lire la suite
lire la suite |
|
|
|
|
2019 |
la Nouvelle Revue du Travail :
Cancers professionnels Le corps
dévalué des ouvriers |
 |
Parmi les salariés exposés aux substances cancérogènes
dans le cadre de leur travail, près des deux tiers sont
des ouvriers. Chaque année, plusieurs milliers de ces
travailleurs – de 14 000 à 30 000 personnes selon le
dernier plan cancer – contractent un cancer en lien avec
leur parcours professionnel, dont la plupart décèdent. À
l’appui d’enquêtes de terrain menées dans deux
territoires longtemps industriels (Lorraine et
Seine-Saint-Denis), auprès de salariés et d’anciens
salariés atteints de cancer d’origine professionnelle et
leurs proches, cet article s’intéresse aux processus
d’évaluation, de catégorisation et de jugements portés
sur ces corps ouvriers, malades du travail, ainsi situés
au cœur d’enjeux politiques et financiers. Dans l’espace
de la réparation de ces maux du travail, le corps
ouvrier n’est pas un « corps neutre », il est à la fois
un « témoin à charge », une « preuve » de situations
exposantes dans l’espace productif, un objet médical lu
à travers des filtres sociaux, reflet de rapports de
domination et enfin, un construit rationalisé,
monétarisé par fragment. |
 lire la suite
lire la suite |
|
|
|
|


![]()
![]()

![]() lire la suite
lire la suite ![]()
![]() lire la suite
lire la suite 
![]() lire la suite
lire la suite ![]()
![]() lire la suite
lire la suite ![]()
![]() lire la suite
lire la suite ![]()
![]() lire la suite
lire la suite 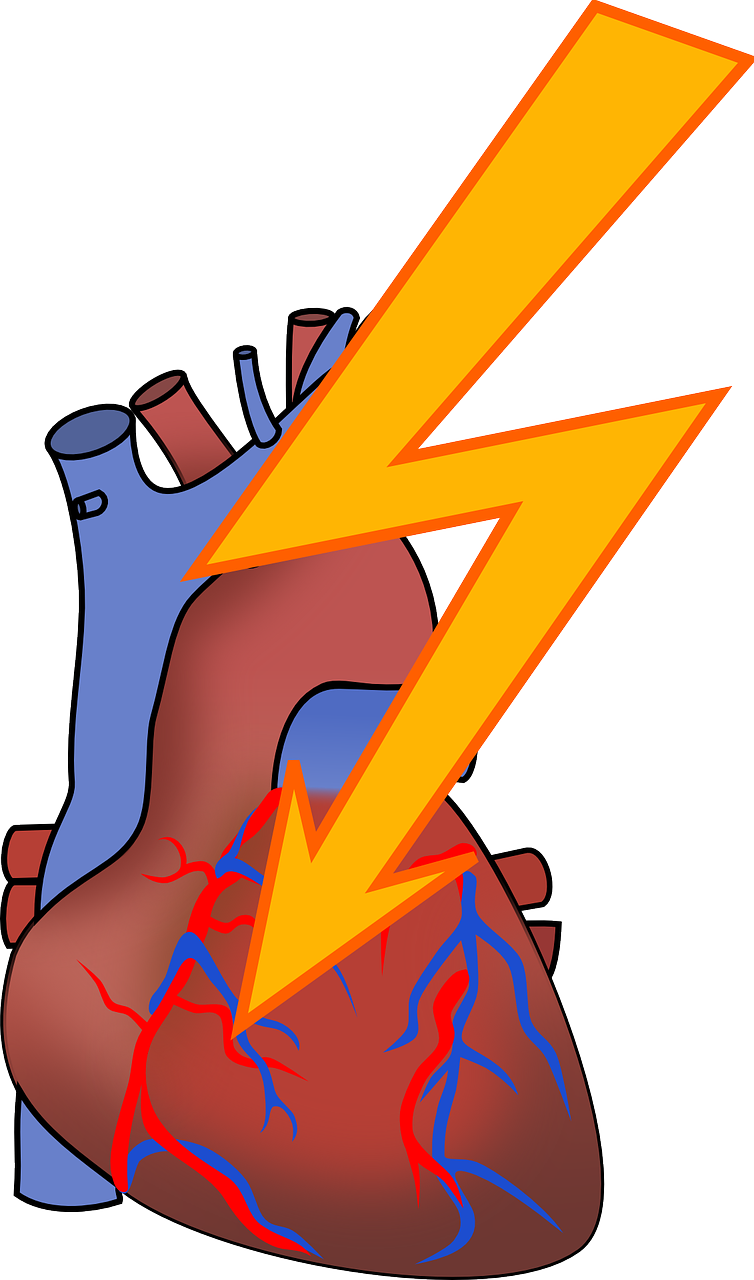
![]() lire la suite
lire la suite ![]() lire la suite
lire la suite